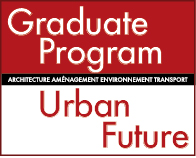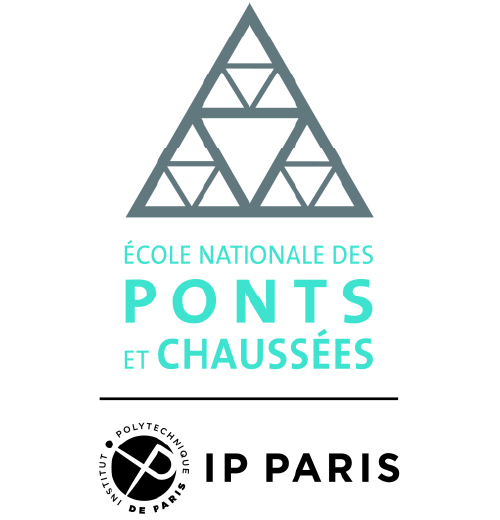Contact
Responsables de l'atelier :
Laurent Coudroy de Lille (UPEC, EUP, Lab'Urba)
laurent.coudroydelille@wanadoo.fr
Loïc Vadelorge (UGE, ACP)
Atelier Patrimoine urbain (S2 2025-2026)
Publics : étudiant.e.s de M1 ou M2 (ENSA-PE, EUP, Master DHAU, Master EST)
Stages de 4 à 6 mois rémunérés par le Graduate Program et en laboratoire (Lab Urba, ACP)
Coordination : Laurent Coudroy de Lille et Loïc Vadelorge
Argumentaire
Les villes européennes sont soumises depuis l’Accord de Paris sur le climat à l’injonction de la transition écologique, qui induit à la fois de contrôler l’étalement urbain et de rénover le bâti public et privé. Refaire la ville sur la ville s’avère cependant complexe dans la mesure où nombre de villes historiques ont tenté de compenser leurs accélérations urbaines de la seconde moitié du XXe siècle en protégeant leurs quartiers anciens (loi sur les abords des monuments historiques de 1943 et loi sur les secteurs sauvegardés de 1962 pour la France, exemples italiens ou espagnols, etc.). Ces quartiers patrimonialisés sont pour partie constitués de bâtiments à faible performance énergétique, qui contribuent au réchauffement climatique. L’horizon de la transition écologique oblige à penser leur adaptation voire à envisager leur remplacement pour les zones de faubourgs, non concernées par les périmètres de protection. Ces contradictions impactent les pratiques et les recherches dans le champ de l’architecture, de l’urbanisme, d’autant que la législation tend à s’assouplir, en particulier sur la notion d’abords.
Parallèlement, la notion de même de patrimoine urbain, qui s’est étendue dans le dernier tiers du XXe siècle (patrimoine immatériel, ethnographique, industriel, photographique,…) à l’échelle nationale et internationale (Unesco) se renouvelle, dans le contexte d’une demande nouvelle de justice sociale, environnementale et culturelle issues notamment des quartiers populaires centraux et plus encore périphériques (à l’exemple de l’exposition Banlieues Chéries tenue au musée de la Porte Dorée d’avril à août 2025).
Contenu de l’atelier de recherche
Ces nouveaux contextes incitent à repenser la notion de patrimoine urbain et à interroger sa pertinence actuelle, dans une perspective de recherche. Il s’agit en premier lieu de faire un état de l’art, pour comparer les analyses classiques (Choay, 1992) et les travaux actuels (Revues In Situ, Histoire urbaine, Cahiers de la recherche architecturale et urbaine, etc.) et poser les bases d’une épistémologie contemporaine du patrimoine urbain. Il s’agit en second lieu de s’appuyer sur les travaux récents ou actuels des étudiants stagiaires pour analyser la manière dont ils composent leurs corpus de recherche et dont ils problématisent les cas d’études, en France comme à l’étranger. Il s’agit en troisième lieu de réaliser une petite étude de cas collective en région Ile de France (probablement sur une commune de l’est parisien joignable facilement en RER. Les cas de Fontenay-sous-Bois ou Torcy sont envisagés) sur les attentes, les modalités ou les obstacles à la patrimonialisation de certains quartiers emblématiques.
L’objectif final est de poser les bases d’un article scientifique collectif qui sera produit durant l’été 2026 par les étudiants stagiaires.
Modalités
L’atelier repose sur une séance collective de travail de 3 heures minimum par mois (synthèse et discussion de l’état de l’art, rencontre avec des doctorants abordant ces sujets, élaboration conjointe de l’enquête, constitution du corpus documentaire, identification des acteurs éventuels à interroger puis état d’avancement du travail collectif, rédaction d’un article collectif) et de séances de tutorat individuels ou collectifs entre les séances.
Lors des séances d’atelier, les projets individuels de recherche (mémoire de master 1 ou 2, projet de thèse) sont présentés et discutés.
Dans la mesure du possible, on proposera une ou deux visites de terrain en Ile de France ou éventuellement dans une grande ville de province (billets collectifs de train pris en charge par le Graduate Program)
Candidatures
Pour candidater, il faut compléter un dossier électronique comprenant :
- Lettre de motivation,
- CV complet,
- Détail de la recherche en cours en M1 ou M2,
- Eventuel projet doctoral
Une audition est prévue en janvier 2026. La date sera donnée ultérieurement.
Réunion d'information
Une réunion d'information a lieu le mardi 16 décembre 2025, de 12h à 13h, au bâtiment Bois de l'Etang en salle C007.
Pour toute question pratique, vous pouvez vous adresser à paul.lesieur@univ-eiffel.fr.
Pour toute question scientifique ou pédagogique, vous pouvez contacter les responsables de l'atelier, Laurent Coudroy de Lille et Loïc Vadelorge.